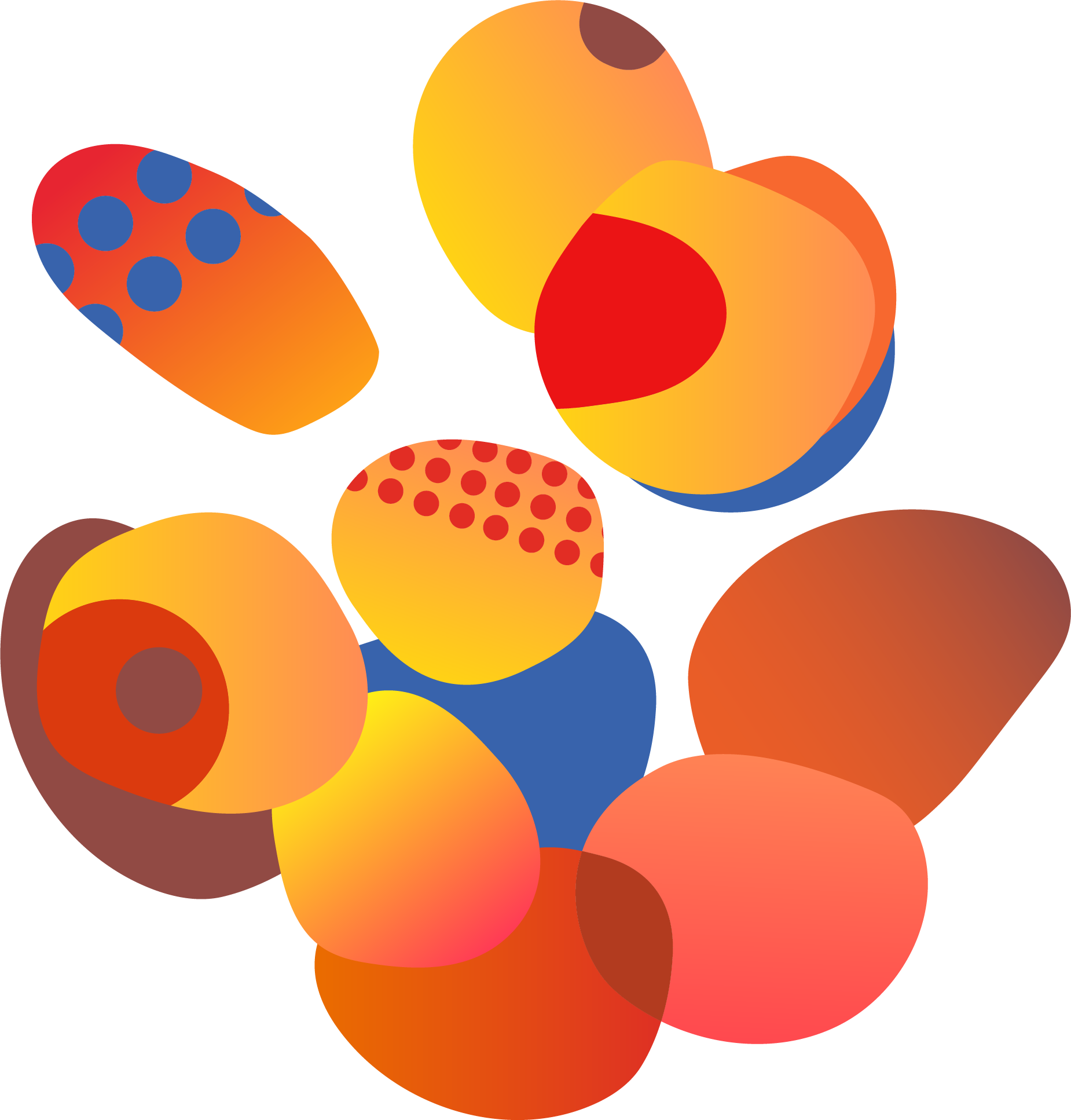Pourquoi parler de genre et d’intelligence artificielle à l’école ?
Nos élèves utilisent déjà l’intelligence artificielle, parfois sans même le savoir. Ils lui demandent de résumer un cours, de traduire un texte, de trouver une réponse rapide, de faire des calculs à leur place, ou encore de créer une image. Ces outils sont pratiques, mais ils influencent aussi la façon dont on s’informe, dont on apprend et parfois même dont on pense. C’est pour cette raison qu’il est important d’en parler à l’école. Pas pour faire des élèves des experts techniques, mais pour les aider à comprendre ce qu’ils utilisent, et à développer un regard critique.
Dans le même temps, l’école reste un lieu essentiel pour parler d’égalité de genre. Les représentations de genre traversent toutes les disciplines et pèsent sur la manière dont les jeunes se projettent dans leurs études, leurs métiers ou leur vie future. Travailler ces questions en classe, c’est leur donner les moyens d’identifier les stéréotypes et de construire peu à peu une société plus équitable.
Ces deux dimensions se rejoignent, parce que l’IA n’est pas neutre. Elle se nourrit des données de la société et en reproduit les inégalités. Une application peut suggérer des métiers différents selon qu’on est un garçon ou une fille, renforcer des clichés dans des images ou dans des exemples, et influencer la façon dont chacun se représente l’avenir.
Aborder ensemble l’IA et le genre en classe, c’est donc aider les élèves à comprendre les outils qu’ils utilisent tous les jours et à repérer les biais qu’ils véhiculent. C’est leur donner le pouvoir de prendre du recul, de faire des choix plus éclairés et de devenir des citoyennes et citoyens attentifs aux enjeux d’égalité.
Mais en fait, c’est quoi un biais de genre ?
Un biais de genre, c’est quand une différence de traitement ou de représentation apparaît à cause de la manière dont le genre est perçu.
Le genre, ce n’est pas seulement le fait d’être une fille ou un garçon. C’est aussi une façon de se sentir, de s’exprimer et de se montrer aux autres (par ses choix, ses attitudes, son apparence, ou simplement par la manière dont on veut être reconnu.e).
Dans notre société, certains stéréotypes sont encore très présents ; par exemple, associer des métiers techniques plutôt aux hommes, ou considérer certaines qualités comme « féminines » et d’autres comme « masculines ». Ces représentations influencent la manière dont chacun.e se projette, et peut par conséquent limiter les possibilités.
Les biais de genre ne concernent pas uniquement le monde du travail. On les retrouve aussi :
- dans les jouets recommandés aux enfants (poupées pour les filles, voitures pour les garçons) ;
- dans la publicité (les produits de soin souvent adressés aux femmes, les sports d’équipe associés aux hommes) ;
- dans la culture populaire (héros courageux contre héroïnes fragiles) ;
- dans les outils numériques qui adaptent leurs contenus selon des suppositions liées au genre.
L’intelligence artificielle, parce qu’elle apprend à partir de données issues de la société, reproduit aussi ces biais. On peut alors obtenir des résultats qui renforcent des clichés tels que : des images où les ingénieurs sont surtout des hommes, où les infirmières sont toujours des femmes, des recommandations de loisirs différents selon le genre attribué, ou des descriptions de caractère qui varient selon que l’on parle d’un homme ou d’une femme.
En parler à l’école, c’est permettre aux élèves de comprendre que la technologie n’est jamais neutre. C’est leur donner les outils pour repérer ces stéréotypes, réfléchir à leurs effets et imaginer des alternatives plus inclusives.
Reconnaître les biais de genre, c’est aussi montrer que chacun.e a le droit d’exprimer son identité comme il ou elle le souhaite, sans être enfermé.e dans des cases.
Comprendre les principes de l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) n’est pas une seule technologie, mais un domaine en constante évolution. Elle regroupe différentes techniques qui permettent aux machines d’imiter certaines capacités humaines comme percevoir des informations (par exemple : des images, des sons ou des textes), apprendre à partir de données, prédire des résultats ou prendre des décisions, et parfois même interagir avec les humains.
Deux grandes approches structurent son développement : l’approche symbolique et l’approche connexionniste.
L’approche symbolique consiste à programmer des règles précises que la machine applique. Cette méthode est claire et contrôlable, mais elle reste limitée aux situations simples et prévisibles.
L’approche connexionniste, ou apprentissage automatique, permet à la machine d’apprendre à partir d’exemples. Elle devient capable de détecter des régularités et de faire des prédictions dans des contextes plus complexes. Cette approche est très puissante, mais fonctionne souvent comme une boîte noire. Il est difficile d’expliquer pourquoi la machine prend telle décision.
Même si les capacités de l’IA sont impressionnantes, elles ne remplacent pas la réflexion humaine. L’IA ne comprend pas le sens de ce qu’elle fait et dépend entièrement des choix humains qui la guident. Comprendre l’IA, c’est donc analyser ses forces et ses limites, identifier les biais possibles, et réfléchir à son impact sur la société, l’école et la vie quotidienne des élèves.
La boîte à outils propose des articles, vidéos et fiches pédagogiques pour approfondir ces notions. Elle permet d’explorer l’IA seule ou en lien avec d’autres thématiques, et de préparer des activités pédagogiques adaptées pour les élèves.
Le genre comme construction sociale et culturelle
Pour comprendre le genre, il est important de distinguer le sexe et le genre.
Le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques (chromosomes, hormones, organes reproducteurs).
Le genre, lui, est une construction sociale et culturelle. Il regroupe les rôles, les normes et les représentations qu’une société associe aux personnes en fonction du sexe qui leur est attribué à la naissance.
Ces attentes ne sont pas naturelles. Elles s’apprennent, se transmettent et évoluent au fil du temps. On les retrouve dans les couleurs associées aux enfants, les jouets proposés, les comportements valorisés ou encore les choix d’orientation. Le genre influence ainsi la manière de s’habiller, les attitudes jugées acceptables, les métiers considérés comme faits pour les hommes ou pour les femmes, mais aussi la façon dont chacun.e se perçoit et souhaite se montrer aux autres.
De façon non exhaustive, on distingue souvent trois dimensions :
- les rôles de genre, c’est-à-dire les comportements attendus (par exemple, attendre des filles qu’elles soient attentives et maternelles, ou des garçons qu’ils soient forts et compétitifs) ;
- les stéréotypes de genre, des idées toutes faites et réductrices qui enferment chacun.e dans des cases ;
- l’identité et l’expression de genre, c’est-à-dire la manière dont une personne se définit et choisit de se présenter aux autres.
Ces dimensions ne sont pas figées. Elles varient selon les époques, les cultures et les contextes sociaux, et elles n’agissent jamais seules. Le genre s’entrecroise avec d’autres facteurs comme l’origine, l’âge, la classe sociale, l’orientation sexuelle ou le handicap. Ces croisements donnent lieu à des expériences différentes d’inégalités et de discriminations.
La boîte à outils met à disposition des articles, vidéos et fiches pédagogiques pour explorer ces notions. Elles permettent d’aborder le genre comme un fait social et culturel, d’ouvrir la discussion en classe et d’accompagner les élèves dans la compréhension des stéréotypes, de l’égalité et de la diversité des identités.